Vendredi 21 mars18h30
Fils d’un guitariste et banjoïste talentueux, Élie Treese, a commencé par faire des études de lettres et de la musique, avant de s’adonner à l’écriture puis de reprendre ses études. Il est maintenant agrégé de lettres modernes et vit à Saintes. Il a déjà publié un premier roman : Ni ce qu’ils espèrent, ni ce qu’ils croient aux éditions Allia (2012). De jeunes garçons arpentent la campagne à la recherche de quelques cigarettes, d’une bière ou d’une fille à conquérir. Ils ont élu refuge dans une maison abandonnée où Carabi, le nouveau venu, projette de mettre à l’abri les trésors de l’enfance. Ensemble, ils s’initient aux jeux de la transgression visant des adultes dépeints sous les traits de la dérision enfantine. Jusqu’à ce que leur amitié se fissure. À mi-chemin de Mark Twain et de Faulkner, ce texte vigoureux et loquace tente de restituer l’intense sentiment de liberté de la prime adolescence et la part de rêve qui lui est inhérente. « La jeunesse est par essence une période de connaissance de soi à travers l’expérience du groupe. Ainsi, dans Les Anges à part, une poignée de gamins se réunissent dans une bâtisse abandonnée de la campagne française. Franck, la Buse, Carabi et « les jumeaux » fument cigarette sur cigarette, glandent sur des fauteuils cassés, tirent parfois à la carabine ou récitent des poèmes sur les nichons des filles, qu’ils espèrent bientôt tâter – comme ceux de la jolie Oiseuse… Mais qu’attendent au fond ces Huckleberry Finn du terroir ? Remarqué avec Ni ce qu’ils espèrent ni ce qu’ils croient (Allia, 2012), le Franco-Américain Élie Treese décrit une sorte de guerre des boutons sans conflits, dans une langue au rythme implacable. » (Baptiste Liger, Lire) La rencontre sera animée par Vincent Taconet. |
Jeudi 20 mars18h30
Né en Colombie en 1965, Santiago Gamboa a étudié la littérature à l’Université Nationale de Bogotá, puis la philologie hispanique à l’Université de Madrid. Journaliste au service de langue espagnole de RFI, correspondant du quotidien El Tiempo de Bogotá à Paris puis diplomate au sein de la délégation colombienne auprès de l’UNESCO à Paris, et conseiller culturel de l’ambassade de Colombie en Inde. Il réside actuellement à Rome. Ses livres sont traduits dans 17 langues. « [...] Quel ogre, ce Gamboa. Un Rabelais d’aujourd’hui, version latine. Ses livres sont des orgies. De douleurs, de douceurs, d’avidité, de culpabilité, de révolte et de dévoration. Il y a cette phrase, qui revient plusieurs fois dans le récit de Manuel au consul : « Je vous préviens, mon histoire n’est pas un roman noir, c’est un roman d’amour. » Mais diable si « ceci n’est pas un roman noir », alors le tableau de Magritte n’est pas une pipe non plus. Bien sûr que c’est un roman noir, il en a tous les codes (prostitution, corruption, drogue, disparition), la grammaire, les profondeurs et les lumières brûlées. Mais pourquoi donc ne serait-il pas aussi un roman d’amour ? Gamboa incorpore les deux à la perfection. C’est aussi un roman sur l’exil et la solitude, la peur non pas de mourir, mais de rester vivant quand et si ceux qu’on aime meurent avant nous. C’est un roman sur la Colombie d’Uribe, enfin, sur ses enfants, qu’elle a enragés, sur les victimes non pas seulement de sa violence « réelle » (les bombes, les meurtres, les attentats), mais de l’autre violence, plus pernicieuse, de la haine et de la délation [...]. » (Marine de Tilly, Le Point) La rencontre sera animée par François Gaudry. |
Mercredi 19 mars18h30
Né en 1967, ancien élève d’HEC, titulaire d’un DEA d’histoire contemporaine à l’Institut d’Études Politiques de Paris, maire de Blanquefort, en Gironde, de 2001 à 2012, Vincent Feltesse est actuellement député de la Gironde et président de la Communauté urbaine de Bordeaux. Spécialiste des questions urbaines (il préside la Fédération nationale des agences d’urbanisme), il a publié en 2012 La décennie bordelaise. Quelle politique urbaine à l’heure des métropoles ? (entretien avec Jean Viard, éditions de l’Aube, 2012). Il a dirigé la campagne numérique de François Hollande en 2012. « Appel à l’engagement, à l’action et à l’audace, à mi-chemin entre le manifeste programmatique et la chronique de campagne, Demain est aujourd’hui est la profession de foi d’un homme de gauche atypique parti à l’assaut de la citadelle bordelaise réputée imprenable, avec la ferme intention de déjouer les pronostics. Vincent Feltesse incarne sans conteste une nouvelle génération politique. » Le débat sera animé par Jean Petaux. |
Mardi 18 mars18h30
Présentation de l’ouvrage Assemblages, 10 ans de Culture et Santé à l’Institut Bergonié co-édité par l’association Script et l’institut Bergonié. En 2003, l’Institut Bergonié, Centre Régional de Lutte contre le Cancer situé à Bordeaux, fait le pari d’une approche non exclusivement sanitaire de la maladie. Dans le cadre du programme national «Culture à l’Hôpital» (aujourd’hui intitulé «Culture & Santé»), l’établissement ouvre ses portes à des artistes et entame avec l’association Script une relation qui durera 10 années. Au fil des saisons, ce compagnonnage s’élargit à d’autres partenaires culturels. Les uns et les autres, par leur attention et leurs initiatives, deviennent des alliés dans le combat que mènent, ensemble, patients, proches et personnel soignant. Ce livre témoigne d’une rencontre féconde entre les mondes de l’art et du soin. Il rassemble des souvenirs, des réflexions et une partie des nombreuses créations réalisées dans ce contexte d’une si troublante humanité. Ce sont les traces d’une expérience riche d’enseignements pour celles et ceux qui l’ont vécue et, peut-être, pour tout professionnel de la culture ou de la santé qui s’interroge sur le sens de sa pratique. Dialogue entre Christian Fillatreau (Bergonié) et Jean-Paul Rathier (Script), animé par Françoise Liot (Université Bordeaux Montaigne).
|
Du 17 au 21 marsLe Trouble
La 17e édition du festival Coupé court se déroule à L’envers (19, rue Leyteire, Bordeaux) du 19 au 21 mars, sur le thème : le Trouble.
|
Samedi 15 mars11h
Pour son livre Prendre langue avec Jacques Lacan. Hybridations (éditions L’Harmattan). Jean-Louis Sous est psychanalyste et membre de l’École lacanienne de psychanalyse. Il est l’auteur de plusieurs articles et de Les p’tits mathèmes de Lacan (L’unebévue, 2000), L’enfant supposé (Epel, 2006) ainsi que deux cédéroms : Lacan et la peinture (2007) et Œdipe (2009). « Ce livre propose dix études sur une série de néologismes lacaniens : la déconnaissance, l’hainamoration, le sujet supposé savoir, le plus de jouir, les quadripodes, le mathème, l’une-bévue, lalangue, le sinthome, s’hystoriser. Loin de considérer que cette forgerie relèverait d’un exercice sophistiqué ou esthétisant, il s’agira plutôt d’en faire résonner la portée doctrinale : faire passer dans le champ théorique de la psychanalyse, la forme du concept à la jouissance d’une langue conceptueuse. La rencontre, organisée par Divan d’Ouest, sera animée par Jean-Louis Meurant. |
Vendredi 14 mars18h30
Éric Fassin est professeur à l’université Paris 8 (département de Science politique et Centre d’études féminines et d’études de genre) et chercheur à l’IRIS et au LabTop / CRESPPA. Serge Guichard est militant, membre fondateur de l’Association de solidarité en Essonne avec les familles roumaines roms (Asefrr). « Pour éviter race, mot par trop malsonnant, on admet plutôt que la « question rom » est une affaire de culture. De fait, la culture rom, sorte d’errance sans but dans un paysage d’ordures, de boue et de rats, est difficilement compatible avec « la nôtre ». D’où leur vocation à ne pas séjourner chez nous, à être expulsés vers leurs pays d’origine où ils trouveront plus facilement leurs marques. Ce livre montre comment l’État français, empêché par ses propres lois de traiter les Roms, citoyens européens, comme il traite les sans papiers tunisiens ou maliens, délègue aux municipalités la tâche de démolir les camps et de chasser leurs habitants. Il montre comment, pour ce faire, maires et adjoints s’appuient sur un réel ou supposé « ras-le-bol » des riverains. Il montre aussi, circulant comme des fantômes, les enfants roms, par terre avec leur mère sur un carton rue du Temple ou cheminant dans la nuit sur le bord de la nationale pour gagner l’école d’une commune éloignée qui accepte de les recevoir. Un livre pour voir ce que nous avons chaque jour sous les yeux. » Le débat sera animé par Christian Jacquot. |
Jeudi 13 mars18h30
Xavier Daverat est professeur à la faculté de droit de l’université Bordeaux Montesquieu, où il enseigne le Droit de la propriété intellectuelle et le Droit civil. Il y dirige les spécialités professionnelles de Masters Droit des créations intellectuelles et Droit et administration des établissements culturels. Il est l’auteur de Tombeau de John Coltrane (Parenthèses, 2012) et le préfacier de l’édition française de Josey Wales hors-la-loi. « Nous sommes sans doute nombreux à avoir vu Josey Wales hors-la-loi, le film de Clint Eastwood et à y avoir décelé, au-delà de la classique histoire de vengeance, un message de fraternité et de tolérance entre les peuples. En préface à cette fort bienvenue édition par Passage du Nord-Ouest, Xavier Daverat remet toutefois pertinemment en lumière les convictions politiques de l’auteur, Forrest Carter, afin d’éclairer l’œuvre sous un angle différent. À travers l’itinéraire de ce fermiers des Monts Ozarks engagé chez les rebelles pendant la guerre de Sécession suite au massacre de sa famille, puis devenu un hors-la-loi pourchassé pour ne s’être pas soumis au serment d’allégeance à l’Union après la paix et se liant en chemin avec un vieux Cherokee et une Cheyenne, Forrest Carter, leader suprématiste blanc et fondateur d’un chapitre du Ku Klux Klan, nous explique Daverat, cherche moins à parler de fraternité que de personnages qui se retrouvent dans le même rejet de l’État fédéral. « (encoredunoir.com) Animée par Bernard Daguerre, la rencontre sera suivie, au cinéma Utopia, de la projection de l’adaptation de Josey Wales hors-la-loi de Clint Eastwood. |
Mardi 11 mars18h30
Maîtrise de lettres en poche, Jean Rouaud exerce divers petits métiers comme pompiste, vendeur d’encyclopédies médicales… En 1978, il entre à Presse Océan et rédige bientôt des papiers pour la une du journal. Il part ensuite à Paris ; il travaille dans une librairie et comme vendeur de journaux dans un kiosque. En 1990, il fait paraître son premier roman, Les champs d’honneur, un coup de maître puisqu’il obtient aussitôt le prix Goncourt. « Il s’en est fallu de bien peu que Les Champs d’honneur, couronnés par les sonneries du Goncourt il y aura bientôt un quart de siècle, ne fussent le tombeau d’une vocation contrariée et d’un auteur fauché dans la fleur de son âge, et qui, au lieu de s’incarner en triomphe, nous serait resté à jamais inconnu. D’abord, le manuscrit avait été refusé partout et par tous. Même Jérôme Lindon, qui se décida finalement à le publier, avait hésité à sortir de sa tranchée funèbre ce texte sans narrateur ni structure visibles. C’était donc Un peu la guerre, pour emprunter au titre, teinté de douce ironie, que Jean Rouaud donne aujourd’hui à ses souvenirs de gloire. C’est donc reparti, comme en 14, et justement nous y sommes. C’est, confesse l’auteur sans se départir de son impeccable dérision, »mon côté mort pour la France ». Si toute son œuvre relève de l’autobiographie (sentimentale, historique ou, comme on dit chez les gens du monde, intellectuelle), c’est avec une si radicale absence de vanité et d’égoïsme qu’il parvient chaque fois à surprendre. [...] Mais ce tour de manège mémoriel est surtout le prétexte à ressusciter les figures d’une certaine mythologie française sans cesse bousculée par l’Histoire, et se nourrissant de ses avatars pour mieux la plier à sa loi. Ce qu’on appelle, en somme, et c’est ici un objet de délice, la littérature. » (Jean-Louis Ezine, Le Nouvel Observateur) La rencontre sera animée par Maïalen Lafite.
|
11, 12 et 20 mars
Mercredi 12 mars à 18h : Marie Laugery donnera une lecture de ses poèmes extraits des recueils Il reste un peu de ciel entre les branches pures, Bleu, planète, Lumières et À l’aube du vent publiés aux éditions Le Solitaire. Jeudi 20 mars à 18h : Béatrice Mauri donnera une lecture de ses poèmes sonores réunis dans le recueil Marasme (La Crypte). |
Samedi 8 mars11h
Suzanne Doppelt est écrivaine et photographe. Associant étroitement littérature et photographie, son travail s’intéresse aux « images-fantômes » et engage une subtile mise en doute du visible. Elle dirige la collection Le rayon des curiosités aux éditions Bayard. Elle a publié, entre autres : Quelque chose cloche, textes et photographies (P.O.L, 2004), Le pré est vénéneux, texte et photographie (P.O.L, 2007), Le monde est beau, il est rond (Inventaire-invention, 2008), Lazy suzie (P.O.L, 2009), La plus grande aberration (P.O.L, 2012), Magic Tour, en collaboration avec François Matton (L’Attente, 2012), Mouche – Une anthologie littéraire avec Daniel Loayza (Bayard, 2013). Poète et philosophe, Philippe Beck enseigne la poétique et l’esthétique à l’université de Nantes. Son travail de poète a été l’occasion de rencontres avec des musiciens et compositeurs contemporains. Parmi les livres de poésie de Philippe Beck, qui donnent lieu à des lectures en France et à l’étranger, on peut citer Dernière mode familiale, postface de Jean-Luc Nancy (Flammarion, 2000), Aux recensions (Flammarion, 2002), Dans de la nature (Flammarion, 2003), Élégies Hé (Théâtre typographique, 2005), Chants populaires (Flammarion, 2007), Poésies premières (Flammarion, 2011). Il vient de publier un volume de poésie Opéradique (Flammarion) et prépare un essai Qu’est-ce que la poésie ? aux éditions Gallimard (Folio Essais Inédits, 2015). Il est l’actuel président de la commission Poésie au CNL. La rencontre, organisée par les éditions Le Bleu du ciel, sera animée par Didier Vergnaud. |
Jeudi 6 mars18h30
Né à Mâcon, Henri Guillemin (1903-1992) a été élève de la prestigieuse École Normale supérieure, où il fut le commensal de Sartre – ils restèrent bons amis – de Nizan et de Jean Guitton. Il fut le disciple et le secrétaire de Marc Sangnier, fondateur du Sillon, mouvement chrétien social. Une amitié très grande liait Guillemin à François Mauriac.Professeur à la faculté de Bordeaux, résistant, il se réfugie en Suisse en 1942. La guerre finie, il devint attaché culturel à l’ambassade de France à Berne, où il restera jusqu’en 1962. « On avait bien compris, à la lecture de son Silence aux pauvres, qu’Henri Guillemin ne se contentait pas, quant à la Révolution française de 1789, des versions officielles et convenues. La suite de conférences, données à la Radiotélévision belge en 1967, réunies ici par les soins de Patrick Rödel et Jean-Marie Flémale, nous le confirme. Pour Henri Guillemin, en 1789, on assiste à une révolution des gens de bien, qui doit permettre à la bourgeoisie d’affaires d’accéder au pouvoir, quitte à le partager avec l’aristocratie dans le respect d’un certain ordre social. La vraie Révolution, populaire, qui se préoccupe réellement des classes pauvres, du Quart État, restait à venir. Elle aura vécu de 1792 à 1794 et sera liquidée avec la mort de Robespierre. C’est donc de ces deux Révolutions françaises que traite ici Henri Guillemin, en bousculant singulièrement, une fois de plus, les idées reçues. » Table ronde avec l’éditeur Jean-Marc Carité, Patrick Rödel et Gérard Boulanger. |
Les derniers coups de coeur de
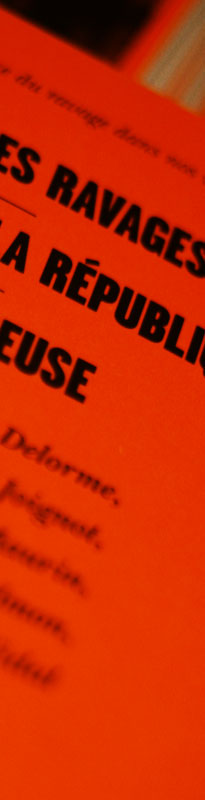







 Pour son roman Les Anges à part publié aux éditions Rivages.
Pour son roman Les Anges à part publié aux éditions Rivages. Pour son roman : Prières nocturnes publié aux éditions Métailié.
Pour son roman : Prières nocturnes publié aux éditions Métailié. Pour son livre : Demain est aujourd’hui ; récit amoureux de Bordeaux aux éditions Le Bord de l’eau.
Pour son livre : Demain est aujourd’hui ; récit amoureux de Bordeaux aux éditions Le Bord de l’eau.


 Autour de leur ouvrage Roms & riverains ; une politique municipale de la race (éditions La fabrique).
Autour de leur ouvrage Roms & riverains ; une politique municipale de la race (éditions La fabrique). Rencontre avec Xavier Daverat, autour du roman de Forrest Carter : Josey Wales hors-la-loi, publié aux éditions Passage du Nord-Ouest.
Rencontre avec Xavier Daverat, autour du roman de Forrest Carter : Josey Wales hors-la-loi, publié aux éditions Passage du Nord-Ouest. Pour son livre Un peu la guerre, publié aux éditions Grasset.
Pour son livre Un peu la guerre, publié aux éditions Grasset. Mardi 11 mars à 18h :
Mardi 11 mars à 18h : Qu’est-ce que la poésie ?
Qu’est-ce que la poésie ? À l’occasion de la parution de l’ouvrage inédit : 1789-1792 / 1792-1794 les deux Révolutions françaises aux éditions Utovie.
À l’occasion de la parution de l’ouvrage inédit : 1789-1792 / 1792-1794 les deux Révolutions françaises aux éditions Utovie.