Samedi 20 avril11h00
Née à Marseille en 1966, Emmanuelle Bayamack-Tam vit et enseigne en région parisienne. Elle est membre fondateur de l’association interdisciplinaire Autres et pareils. Parmi ses ouvrages déjà publiés chez P.O.L : Rai-de-cœur (1996), Tout ce qui brille (1997), Hymen (2003), Une fille du feu (2008), Mon père m’a donné un mari (2013). Elle vient de recevoir le prix Alexandre-Vialatte 2013. « Si je dois avoir une famille, alors que Baudelaire soit mon frère et Janis Joplin ma sœur. Qui ne s’est laissé, adolescent, envahir par une pensée de ce genre. Kim, en cela, est comme les autres. En cela seulement. Pour le reste, on comprend, à lire Si tout n’a pas péri avec mon innocence,… que l’idée d’avoir une famille n’enthousiasme pas la narratrice. Dotés d’une impayable capacité à se considérer comme vernis, puisqu’ils sont ce qu’ils sont, au-delà de toute critique et comparaison, les membres de la famille Chastaing-Meuriant-Vidal font de l’autosatisfaction un style de vie, mieux, un art… La tragédie, le « goût du sang », imprègnent ce roman, qui ne saurait se réduire à un allègre récit d’apprentissage. Mais Emmanuelle Bayamack-Tam a gardé dans son écriture la justesse et l’énergie de ceux qui l’ont précédé, en particulier Une fille de feu, dont l’opulente héroïne, Charonne, croise le destin de Kim. Si tout n’a pas péri avec mon innocence est un livre éblouissant, qui devrait imposer définitivement Emmanuelle Bayamack-Tam parmi les grandes voix de sa génération. » (Alain Nicolas, L’Humanité) La rencontre sera animée par Pierre Mazet. |
Vendredi 19 avril18h30
À propos de son ouvrage Un million de révolutions tranquilles ; Travail, Argent, Habitat, Santé, Environnement, comment les citoyens changent le monde publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Bénédicte Manier est journaliste, spécialisée dans les droits sociaux, le développement et les transformations sociales. Elle a effectué de nombreux reportages de terrain dans plusieurs pays et notamment en Asie. Elle est l’auteur de Quand les femmes auront disparu. L’élimination des filles en Inde et en Asie (La Découverte, 2008) et Le travail des enfants dans le monde (La Découverte, 2011). « Lasse d’entendre qu’aucune alternative n’était possible au libéralisme économique, Bénédicte Manier, journaliste, a pris son bâton de pèlerin et sillonné la planète. Les fruits de son périple sont exaltants ! Il existe bien de par le monde des citoyens qui ont mis en place d’autres manières de consommer, de commercer, d’échanger, de cultiver, de vivre… qui se sont affranchis du modèle consumériste, créant parfois leur propre monnaie, leurs banques, gérant eux-mêmes leur approvisionnement en eau et en énergies, reverdissant le désert ou organisant de nouvelles façons de travailler ensemble. Ces multiples initiatives, l’auteur les décrit. Il n’y a que des citoyens ordinaires mais animés d’une volonté extraordinaire qui tentent de répondre aux problèmes qui leur sont posés localement (manque d’eau, de nourriture ou de logements, terres polluées…). En Inde, en Afrique, aux États-Unis, en Europe, ce livre dessine ainsi les frontières de cet « autre monde possible ». À lire absolument ! » (L’Écologiste) Débat animé par Anne-Sophie Novel. |
Mardi 16 avrilJean Lojkine a du annuler sa venue pour des raisons de santé, et vous prie de l’en excuser. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et nous espérons qu’il sera parmi nous à une autre occasion.
Jean Lojkine est agrégé de philosophie, sociologue, et directeur de recherche émérite au CNRS. Il est membre des comités de rédaction des revues La Pensée et Actuel Marx. Il collabore aux travaux de la Fondation Gabriel Péri. Il a publié plusieurs ouvrages dont L’adieu à la classe moyenne (La Dispute, 2005). « Le nouveau livre de Jean Lojkine est passionnant. Mêlant politique et histoire, théorie accessible et polémique sérieuse, il expose en cinq chapitres clairs une vision solidement étayée d’une stratégie possible pour les forces progressistes. Partant de la contradiction entre l’emprise confirmée des thèmes néolibéraux sur les peuples et les grands mouvements sociaux qui marquent la France, l’Espagne et les pays arabes, l’auteur cherche à répondre à une question : « Comment donner une force politique à tous ces mouvements venus d’en bas ? »… Il apporte une analyse renouvelée de la « révolution informationnelle ». C’est pour lui l’occasion d’approfondir l’ambivalence et la force de cette mutation qui développe une logique non marchande, alors même que la marchandisation de l’informationnel n’a jamais été poussée aussi loin à travers la financiarisation du capital. Cette transformation fait que la réponse à la crise actuelle ne peut être réduite à une répétition de celle apportée à la grande crise de 1929. » (Jean-Christophe Le Digou, L’Humanité) La rencontre, organisée par Espaces Marx Bordeaux, sera animée par Vincent Taconet. |
Mardi 16 avril18h30Cinema Utopia, salle de la Cheminée.
Philippe Baqué est journaliste indépendant, collaborateur du Monde diplomatique, de Politis, de Silence, de Témoignage Chrétien… Il a déjà publié Un nouvel or noir (éditions Paris Méditerranée) et réalisé plusieurs films documentaires : Carnet d’expulsion, de Saint-Bernard à Bamako et Kayes ; Melilla, l’Europe au pied du mur ; L’Eldorado de plastique ; Le Beurre et l’argent du Beurre. « Les contributeurs sont agriculteurs, journalistes, sociologues, etc., tous convaincus des vertus de l’agriculture bio. Bien plus qu’une technique agronomique, elle est à leurs yeux porteuse d’un projet de société. Mais ils sont aussi conscients des dérives qu’elle connaît, du fait du « biobusiness » des grandes enseignes et de l’industrie agroalimentaire, du fait aussi du diktat des labels (AB compris), de l’attitude pas si exemplaire de certains acteurs historiques… De l’Espagne à la Palestine en passant par la Colombie et bien d’autres pays, dont la France, ils sont allés à la rencontre d’acteurs de « la » bio mais aussi « du » bio (autrement dit ceux qui n’en ont qu’une vision industrielle). Chemin faisant, ils rendent compte de la diversité des pratiques porteuses d’espoir (jardins communautaires, groupements d’achat, etc.). Autant ils se montrent sceptiques à l’égard de l’agriculture « écologiquement intensive » ou à « haute valeur environnementale », qui ne se préoccuperait pas assez des conditions de travail, autant ils parient sur l’agroécologie, que les Nations unies reconnaissent d’ailleurs comme une réponse appropriée aux défis alimentaires. Dans le genre « Les coulisses de… » ou « Le livre noir de… », cet ouvrage est très réussi : militant tout en étant lucide, critique tout en se gardant de jeter le bébé avec l’eau du bain. » (Sylvain Allemand, Alternatives Économiques) La rencontre est organisée dans le cadre de l’Université Populaire de l’Environnement. Elle sera suivie à 20h30 de la projection du film documentaire de Silvia Pérez-Vitoria Les mandarines et les olives ne tombent pas du ciel. |
Vendredi 12 avril18h30
Agrégée de lettres modernes, Camille Laurens enseigne à l’Institut d’Études Politiques de Paris. Elle est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages dont : Romance (POL, 1992), L’Avenir (POL, 1998) et Romance nerveuse (Gallimard, 2010). Ses livres sont traduits dans une trentaine de langues. « C’est fini ? Recommence alors… Il pourrait y avoir comme un paradoxe à écrire des « variations » sur la répétition. La variation, c’est le changement, la diversité, l’écart. On lui attribue des vertus : le changement est bénéfique, dit-on. La répétition, elle, est monotone, on l’associe à l’ennui. Or, dans Encore et jamais, Camille Laurens nous explique que la répétition se décline, elle est plurielle, toujours la même mais jamais identique. Encore, donc, mais jamais, aussi. Un recommencement renouvelé à chacun de ses débuts. Chaque répétition, quoi qu’on en dise, reste unique… Le paradoxe n’est alors qu’apparent. 38 variations se « proposent d’explorer les pouvoirs de la répétition dans nos vies ». « Répétons-nous pour notre malheur ou notre plaisir ? Répéter est-ce vivre à grandes guides ou bien mourir à petit feu ? » nous demande Camille Laurens, dans son « avant-dire ». Pour y répondre, elle chemine. Nous emporte d’abord à travers un souvenir, peut-être le premier lié à la répétition, où s’origine ce livre. C’est celui de sa grand-mère refaisant chaque jour les gestes immuables du ménage qui amène l’auteur, encore enfant, à s’interroger : « Et si routine et ressassement formaient l’essence du féminin » ?… Ces variations où le thème rencontre le sujet, où la répétition croise Camille Laurens révèlent queEncore et jamais est bien plus qu’un essai. Il est une magnifique réflexion dans tous les sens du terme : une pensée – juste et fine – mais aussi un retour à soi. À l’être intime. Il est le livre de la vie qui nous rappelle à la vie. À ses retours, ses redites, ses reprises, ses ressassements. Seule la Mort, Elle, ne se répète pas… » (Arnaud Genon, La Cause Littéraire) La rencontre sera animée par Florence Signon et Philippe Madet. |
Jeudi 11 avril18h30
Marie-Louise Chapelle pour Prononcé second, Isabelle Garron pour Corps fut : suites & leurs variations (2006-2009), Yves di Manno, directeur de collection. « Créée en 1985 par Claude Esteban, la collection « Poésie/Flammarion » est animée depuis 1994 par Yves di Manno, qui y a accueilli plus de 120 titres à ce jour, d’une cinquantaine de poètes contemporains. L’idée était dès l’origine d’en faire un lieu ouvert, sans a priori ni exclusive, susceptible d’accueillir des œuvres très différentes – voire esthétiquement opposées – mais participant toutes au profond renouveau de l’écriture poétique en France ces dernières décennies. Loin d’illustrer une ligne – et moins encore de répondre aux mots d’ordre d’un cénacle – il s’agissait de montrer la richesse et la diversité de ces recherches, en mettant notamment l’accent sur un certain nombre de voix isolées, de parcours atypiques, d’univers parallèles… » Marie-louise Chapelle est née à Nevers en 1974. Elle a commencé à publier au tout début des années 2000 dans la revue Fin. Son premier ouvrage : mettre. est paru en 2006 au Théâtre typographique. Né en 1954, Yves di Manno a collaboré à de nombreuses revues et travaux de traduction de poètes américains (Ezra Pound, William Carlos Williams, Jérôme Rothenberg…). Il est l’auteur d’une vingtaine de recueils de poèmes. Rencontre animée par Fabienne Rihard-Diamond et organisée à l’initiative de l’université Michel de Montaigne Bordeaux 3. |
Mardi 9 avril18h00
Christine Chivallon est anthropologue et géographe et directrice de recherche au LAM-CNRS (Institut d’études politiques de Bordeaux, université de Bordeaux). Elle est l’auteur d’ouvrages et de nombreux articles portant sur les sociétés de la Caraïbe et les questions de la construction identitaire. Elle est également cofondatrice et coresponsable du programme d’enseignement « France Caraïbe ». « Cet ouvrage propose une étude de grande envergure, première du genre, sur la mémoire et le souvenir de l’esclavage. En analysant les débats politiques et académiques des vingt dernières années, l’auteur dégage deux approches : celle du soupçon politique (victimisation, instrumentalisation, surenchère) et celle du doute anthropologique (fragilité, absence, vide). Ayant établi ce constat, Christine Chivallon part alors à la recherche des traces du souvenir de l’esclavage, ainsi que des témoins qui les transmettent, pour comprendre la teneur des expressions mémorielles issues de l’expérience esclavagiste. L’étude de l’Insurrection du sud, qui a opposé, à la Martinique, anciens maîtres et anciens esclaves, en 1870, au moment de l’instauration de la Troisième République, forme le pivot de ce parcours. Elle permet de reconstituer une scène primordiale de violence et d’en trouver les expressions transmises au sein des descendants des insurgés, témoins d’aujourd’hui. L’approche de cet évènement fondateur fournit l’occasion d’aller bien au-delà de la découverte de récits de mémoire minorés pour explorer les différentes manières de transmettre, de s’emparer ou « d’incorporer » le passé, dans un contexte (post)colonial, formé dans la double matrice de l’esclavage et de la République… » La rencontre, organisée dans le cadre des Géo-Mardis d’ADES, sera animée par Pierre-Yves Saillant. |
Mercredi 3 avril18h30
Né dans une famille d’agriculteurs, Jean-Marie Lespinasse a quitté l’école, à quinze ans, pour aider ses parents dans les vignobles et le jardin. À vingt ans, il entre comme ouvrier agricole à l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) de Bordeaux. Il a, entre autres, publié De la Taille à la conduite des arbres fruitiers (Rouergue, 2005) et Les Fruits Retrouvés, patrimoine de demain (Rouergue, 2008). « À une époque, où le respect de la nature devient une préoccupation capitale pour notre avenir, le fait de travailler la terre sans produits chimiques ni engrais constitue un nouvel enjeu pour les jardiniers et les collectivités. Jean-Marie Lespinasse… donne les clefs pour cultiver son potager sans pesticides ni herbicides. L’expérience de l’auteur dans son jardin en terre des graves part du principe de la reconstitution d’un écosystème. En s’inspirant du sol des sous-bois, il revendique de ne plus retourner la terre, ni de la bêcher, ni de la labourer mais de favoriser l’utilisation de la matière organique facilitant et stimulant la vie (micro-organismes, faune et flore). Cette méthode favorise les échanges avec les racines des plantes. Une autre astuce importante est la surélévation de 50 centimètres des massifs par rapport aux allées. En effet, Jean-Marie Lespinasse préconise la méthode des « ados » (talus de terre cultivée placé contre un mur et incliné afin de la soustraire à l’action des vents tout en la faisant bénéficier au maximum de l’ensoleillement). Ce principe favorise l’aération du sol et la circulation de l’eau tout en limitant les problèmes de mal de dos. Une autre action importante lorsqu’un jardinier veut adopter une démarche biologique est la gestion raisonnée de l’eau, modérée et ciblée. Jean-Marie Lespinasse revient également sur les modes de culture des légumes, bulbes et condiments comme sur les travaux hivernaux. En appliquant ces méthodes issues du savoir-faire de l’auteur et en utilisant les outils appropriés, tout en respectant les capacités naturelles des plantes, le jardinier aboutira à un résultat des plus gratifiants : pouvoir manger des légumes sains, ses bien nommés « propres » légumes. » (Conservatoire des jardins et paysages) La rencontre sera animée par Danielle Depierre. |
|
La Machine à Lire y représentera les éditions : Actes-Sud, Atelier du poisson soluble, Atelier, Aube, Autrement, Calmann-Lévy, Casterman, École des Loisirs, Flammarion, Gallimard, Gallimard Jeunesse, Grandes Personnes, Grasset, Hélium, In8, Les Liens qui libèrent, Mercure de France, Minuit, Nathan, Petits Platons, Publie.net, Sabine Wespieser, Seuil, Thierry Magnier, Tishina, Verdier. L’équipe de la librairie vous invite au cours de ces trois journées à rencontrer les auteurs : Sophie Avon, Andrea Bajani, Alessandro Baricco, Aurélien Bellanger, Emmanuèle Bernheim, François Bon, Vincent Borel, Gérard Boulanger, Laurence Brisset, Catherine Cusset, Rébecca Dautremer, Jean-Baptiste Del Amo, François Dubet, Éric Macé et Sandrine Rui, Alaa El Aswany, Vincent Feltesse, Philippe Forest, Anne-Marie Garat, François Garcia, Catherine Guillebaud, Jean-Marie Harribey, Gilles Kepel, Michèle Lesbre, Jean-Daniel Magnin, Jean Mattern, Philippe Motta, Marie NDiaye, Marie Nimier, Maxime Ossipov, Pia Petersen, Yves Ravey, Léonor de Recondo, Mathieu Riboulet, Walter Siti, Anne Wiazemsky, et sera heureuse de vous retrouver vendredi à 19h, lors de l’inauguration, pour un moment festif. Les plus jeunes ne sont pas oubliés, l’équipe de la librairie vous propose de rencontrer sous le chapiteau jeunesse : Marie Caudry, Anne Cortey, Michaël Escoffier, Kris Di Giacomo, Isabelle Gil, Jean Lecointre, Jean-Paul Mongin, Nadja, Pakita, Alice de Poncheville, Alex Sanders, Éric Sanvoisin et Annette Tamarkin. |
Mardi 2 avril18h30
Guillaume Duval est rédacteur en chef du mensuel Alternatives économiques. Ingénieur de formation, il a travaillé pendant plusieurs années dans l’industrie allemande. Il est l’auteur de Sommes-nous des paresseux ? 30 autres questions sur la France et les Français (Le Seuil, 2008) et de La France d’après. Rebondir après la crise (Les Petits Matins, 2011). « Si l’Allemagne a mieux résisté que la plupart des autres économies à la crise, c’est aussi parce que son marché du travail est demeuré peu flexible. » « La France qui doute ne cesse de se pâmer devant le modèle allemand. Elle n’a pas tort, écrit Guillaume Duval, mais le modèle qu’elle admire n’est pas nécessairement le bon. Guillaume Duval est un fin connaisseur de l’Allemagne, où il a travaillé dans l’industrie. Sa thèse, originale et à contre-courant des idées défendues par les « germanodôlatres » français, est que le réformisme des années Schröder, loin de résumer à lui seul l’insolente résistance du pays à la crise, l’a au contraire fragilisé, comme en atteste la très forte progression de la pauvreté. Si l’on veut trouver les vraies racines de la résilience allemande c’est vers d’autres caractéristiques de son modèle qu’il faut se tourner : un cocktail fait d’un système social structuré par les corps intermédiaires, un système de formation qui ne dégage pas une élite par la seule élimination des plus faibles, une décentralisation qui dissémine dans le pays le capital humain et financier nécessaire à son développement, l’absence de bulle immobilière grâce à - ou à cause de - une population qui décroît et, bien sûr, une spécialisation industrielle centrée sur les biens d’équipement qui a épousé au bon moment la demande forte des pays émergents. » (Daniel Fortin, Les Échos) La rencontre sera animée par François Dupont (commission Europe EELV Aquitaine) et sera suivie d’une conférence salle Jean Lurçat à Bègles, de 20h30 à 22h. |
Vendredi 29 mars18h30
Historien et écrivain, auteur d’une centaine d’ouvrages, membre de l’Institut Jean Moulin, prix de la Légion d’honneur, Dominique Lormier est l’un des meilleurs spécialistes de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance française. Il collabore également à de nombreuses revues historiques. « Cet ouvrage captivant, reposant sur des archives et des témoignages souvent inédits, offre un panorama complet et détaillé de la Gestapo en France. Cette police secrète d’État du régime nazi, chargée de lutter contre les ennemis politiques, de traquer les Juifs et les résistants, regroupa une vingtaine d’antennes régionales et une centaine d’antennes départementales. On découvre ici l’implantation massive de cette organisation, forte de 2 500 agents allemands, 6 000 agents français et 24 000 informateurs. Le bilan de leur action demeure effrayant : 300 000 arrestations, 30 000 fusillés, 88 000 déportés politiques et résistants dont 35 200 morts en camps, 25 000 FFI tués au combat, 76 000 Juifs déportés dont seulement 2 280 sont revenus. On découvre en outre comment la Résistance, bien que durement frappée, mit en échec l’une des principales missions de la Gestapo. Enfin, l’auteur s’attarde longuement sur la sanglante retraite de cette police secrète, ainsi que sur la manière honteuse dont la Justice a bâclé son action : les principaux chefs gestapistes, quoique coupables d’innombrables crimes, devinrent après la guerre des notables respectés, des juges, des policiers, de hauts fonctionnaires, voire des agents des services secrets alliés, notamment, des États-Unis. » Le débat sera animé par Christophe Lucet. |
Jeudi 28 mars18h30
Sébastien Charbonnier est professeur agrégé de philosophie et docteur en sciences de l’éducation. Il est l’auteur de Deleuze pédagogue (L’Harmattan, 2009). « Le livre de Sébastien Charbonnier… pose de manière intelligente et singulière, la question de l’émancipation intellectuelle et donc politique de la pratique philosophique comme le seul projet qui vaille d’être retenu comme prolégomènes à toute philosophie future. Que nous soyons philosophes ou non, cet essai a le mérite de nous conduire à réfléchir et à agir sérieusement en ce sens, en interrogeant les professionnels de la philosophie sur leur besoin irrépressible de se vêtir des oripeaux et des colifichets de l’aristocratisme intellectuel afin de légitimer leurs propres pratiques. Que peut la philosophie ? Voilà bien une question qui ne devrait pas laisser insensibles tous ceux pour lesquels l’exercice et l’expression philosophiques ne trouvent aucunement sa réalisation dans l’exutoire des multiples proclamations démagogiques d’un Besoin de philosopher (savamment interrogé par Jacques Bouveresse dans sa Leçon inaugurale au Collège de France) très largement mercantiliste et qui cherche coûte que coûte à installer des petits maîtres à penser prescrivant ce qu’il en est. Cet exutoire n’a toujours pas compris que le libre exercice de penser, en quoi consiste l’exercice et l’expression philosophiques, est en soi révolutionnaire, car il nous dispense à jamais de croire en un ultime fantasme: celui de prétendre concevoir la totalité des possibilités infinies de l’exercice philosophique ! » (Stéphane Cormier) Le débat sera animé par Stéphane Cormier. |
Les derniers coups de coeur de
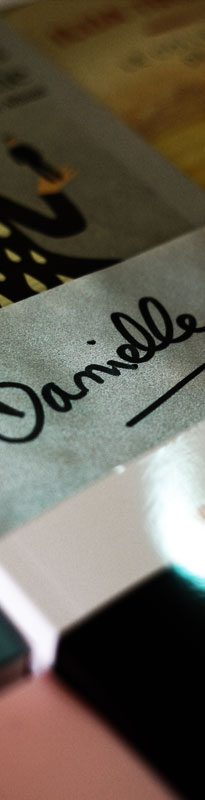







 Autour de son roman Si tout n’a pas péri avec mon innocence publié aux éditions P.O.L.
Autour de son roman Si tout n’a pas péri avec mon innocence publié aux éditions P.O.L.
 Pour son livre : Une autre façon de faire de la politique publié aux éditions Le Temps des cerises.
Pour son livre : Une autre façon de faire de la politique publié aux éditions Le Temps des cerises. Autour de l’ouvrage collectif dont il a assuré la direction : La Bio entre business et projet de société publié aux éditions Agone.
Autour de l’ouvrage collectif dont il a assuré la direction : La Bio entre business et projet de société publié aux éditions Agone. Pour son livre Encore et jamais, variations publié aux éditions Gallimard.
Pour son livre Encore et jamais, variations publié aux éditions Gallimard. Marges, limites, frontières de la poésie, rencontre autour de la collection Poésie aux éditions Flammarion, avec :
Marges, limites, frontières de la poésie, rencontre autour de la collection Poésie aux éditions Flammarion, avec :
 Christine Chivallon pour son ouvrage : L’Esclavage, du souvenir à la mémoire ; contribution à une anthropologie de la Caraïbe publié aux éditions Karthala.
Christine Chivallon pour son ouvrage : L’Esclavage, du souvenir à la mémoire ; contribution à une anthropologie de la Caraïbe publié aux éditions Karthala. Pour son ouvrage Le jardin naturel publié aux éditions du Rouergue.
Pour son ouvrage Le jardin naturel publié aux éditions du Rouergue.
 Pour son livre Made in Germany, le modèle allemand au delà des mythes publié aux éditions du Seuil.
Pour son livre Made in Germany, le modèle allemand au delà des mythes publié aux éditions du Seuil. Autour de son ouvrage La Gestapo et les Français publié aux éditions Pygmalion.
Autour de son ouvrage La Gestapo et les Français publié aux éditions Pygmalion. Pour son ouvrage : Que peut la philosophie ? Être le plus nombreux possible à penser le plus possible publié aux éditions du Seuil.
Pour son ouvrage : Que peut la philosophie ? Être le plus nombreux possible à penser le plus possible publié aux éditions du Seuil.